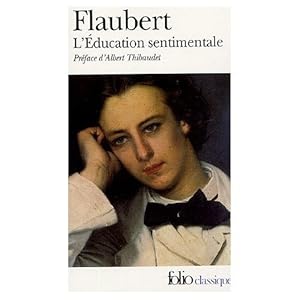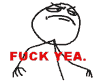X a écrit :Ce que je ne fais absolument pas. Si c’est l’impression que donnait mon premier message, je me suis mal fait comprendre. Flaubert a
aussi
abordé la séduction et les rapports homme-femme.
Comme à peu près tous les auteurs de son époque, et d'avant, et ceux depuis

Pourquoi ne pas parler de Stendhal alors ? Il se pose là, aussi, en termes de critique du romantisme (enfin, sa position est sans doute plus nuancée et moins ironique que celle de Flaubert, mais
le Rouge et le noir est quand même loin de
René de Chateaubriand).
X a écrit :Tu pourrais développer la différence entre les deux « romantismes » s’il te plaît. C’est vrai que si on réduit « Romantisme » à fleur-chocolats, ouais, c’est clair. Mais globalement, je trouve que les idées qui sous-tendent le Romantisme de l’époque sont encore très présentes aujourd’hui dans le divertissement populaire (mèm si wesh le délire de boté dans la tchatche genre parler comme un aristo tro chelou, on l’a renvoyé chez sa mère avec les mecs trop bogoss que fait la téloch genre Michael Vendetta

), avec une part d’effets proches de ceux de Flaubert. Bon, après, oui, il y a quand même une mesure à garder, nous ne sommes pas (encore ?) les héritiers époque de bouleversement sociétaux majeurs, comme l’après Napoléon de Flaubert.
Pardon de dérouler des évidences mais on parle d'un courant intellectuel et artistique, quand on parle du romantisme du 19è. Tu vois de l'AFCisme dans les tableaux de Delacroix ou de Géricault ? Pourtant ce sont eux aussi des artistes romantiques.
Romantisme, à la base, vient du terme « roman » : ça n'a rien à voir avec la relation amoureuse, c'est une manière de voir la vie et le monde tout entiers. En France plus précisément (parce que selon les pays le romantisme a eu des expressions bien différentes : Emily Brontë était une romantique, pourtant
les Hauts de Hurlevent n'ont pas grand-chose en commun avec les œuvres de Hugo, par exemple), le romantisme est apparu en réaction contre la philosophie des Lumières qui a fait les beaux jours du 18è siècle, et ont placé (enfin, à une exception près, celle de Rousseau qu'on peut classer dans les grands auteurs romantiques) la raison avant tout autre chose. Les auteurs du 19è siècle, eux, décident que finalement, la raison ne leur a rien apporté (la Révolution française qu'on chérit tant a été un semi-échec, les mêmes inégalités se sont perpétrées, et pour remplacer la monarchie on a eu l'empire : les idéaux politiques se sont écroulés) et ils vont alors préféré l'exaltation du moi, du je (ce qu'on appelle le lyrisme en poésie).
Pour faire vite, le style romantique est un style qui fait la part belle aux sentiments (mais pas uniquement amoureux et pas uniquement idolâtres envers l'être aimé : on n'est pas que dans l'élégie, preuve en est du très connu
Demain dès l'aube de Hugo qui parle de sa fille décédée), sentiments souvent mis en relation avec la nature, violente, libre. C'est le domaine du rêve, de l'individu aussi (et oui, notre société est pleinement héritière de cette conception de la vie), de la richesse intérieure, de la mélancolie : le romantique est rarement heureux, et son désespoir n'est pas forcément qu'amoureux.
Voilà quelques pistes pour savoir ce qu'est le romantisme en littérature. Bien évidemment qu'il y a un lien entre ce mouvement artistique et ce qu'on appelle aujourd'hui « romantisme », c'est-à-dire les fleurs, les dîners aux chandelles, bref les situations un peu clichées qui prennent place dans la relation amoureuse. Sauf qu'il faut bien garder à l'esprit que l'essence même du romantisme littéraire a été énormément dévoyé pour en arriver à un mot aussi commun et bien souvent, mal employé.
Pour aller plus loin, ne jamais oublier une chose : les personnages d'un roman ne sont pas des personnes. Essayer d'analyser leur psychologie mène bien souvent dans l'impasse, car de nombreux romanciers se moquaient bien de la crédibilité dans ce domaine-là (hormis avec le réalisme et le naturalisme, où on tend sans doute davantage à la peinture de personnages crédibles). Quand Flaubert met Rodolphe sur la route d'Emma, il ne crée pas une vraie personne, douée de sentiments et de raison : c'est un
topos, pas une vraie personne. C'est le séducteur impénitent, sans scrupules, et qui use d'une rhétorique ridicule pour la séduire — et elle, toute qu'elle est à son malheur, se laisse avoir, pas par ses paroles, mais parce qu'elle veut se laisser avoir et vivre autre chose : elle non plus n'est pas une vraie personne de sexe féminin, c'est le cliché de la femme de province qui s'emmerde et veut croire que la vie, c'est plus que ça, cf. Flaubert : « Ma pauvre Bovary souffre et pleure dans vingt villages de France. »
X a écrit :Oui, mais il faut quand même remarquer que les AFC purs et durs, souvent, ils ont une réalité sentimentale médiocre, d’où la fuite vers « l’idéal » des productions culturelles (livres à l’époque de Flaubert, vidéo aujourd’hui avec la télé et le cinéma). « Madame Bovary = AFC », non, ce serait tout de même exagéré de la réduire à ça. Cependant, je pense que dans le processus qui mène la Bovary à la ruine et celui qui anime les AFCs transis, il y a une certaine similarité, d’où que je les rapprochais. Et pas que les AFC d’ailleurs : des gens avec une vie affective inexistante, et qui commence une idéalisation malsaine à la Bovary, ça se trouve.
Dernier point, il faut se rappeler que Flaubert est un homme. S’il a pu trouver en lui les ressources pour écrire un tel roman, c’est que le problème ne devait pas être spécifique à la condition féminine. Même si je ne nie pas que les femmes étaient peut-être plus disposée à une telle dérive à l’époque à cause de leur condition sociale.
Il y a de nombreux AFC qui n'ont aucun idéal chimérique, qui n'ont pas besoin de livres ou de films pour se sentir seuls et malheureux.
D'ailleurs, je persiste et signe : je pense qu'on fait une erreur en analysant le mal de vivre d'Emma Bovary par son rapport aux romans. Son rapport aux romans est la conséquence de son mal de vivre : que peut-elle bien faire d'autre de ses journées, si ce n'est lire, et lire encore ? Elle s'ennuie, Emma. Voilà son plus grand malheur, sa grande douleur — et c'était celles de nombreuses femmes de son époque, qu'on laissait croupir à la maison pour s'occuper d'enfants que parfois elles n'aimaient pas (l'amour maternel n'étant pas systématique). Du coup, elle lit des livres, et du coup, le premier mec venu, elle l'épouse. Et comme elle s'ennuie encore, le premier qui veut bien la sauter autrement que dans un lit, eh bien elle le suit, là encore.
Et elle consomme. Elle s'achète des robes, parce qu'elle se fait chier, et ça la mènera à sa perte : elle ne se suicide pas par amour, elle se suicide parce qu'elle a trop de dettes. Ça en fout un coup, quand même, à l'image de fille idiote qui rêve tellement au grand amour qu'elle va se tuer pour lui...
Quant au point sur le sexe de Flaubert, j'ose espérer que tu n'as aucun doute sur le fait que j'étais au courant depuis longtemps : Gustave est bien un prénom masculin. Je ne vois absolument pas en quoi ça l'aurait empêché d'avoir un regard sur la condition féminine de son époque. C'est à déplorer mais je constate que les romans les plus forts concernant la cause féminine ont été écrits par des hommes — à quelques petites exceptions près. Personnellement, je trouve que c'est un peu cliché de se dire qu'un homme ne peut pas écrire un roman qui porte un regard vrai sur les femmes. Encore heureux, on n'est pas simplement réduit à notre sexe, et on est capable de voir plus loin, et ce qui se passe de l'autre côté.
X a écrit :Je ne sais pas. Encore une fois, je ne prétends pas que notre époque a réinventé Flaubert, mais ce qui me surprend est une certaine similarité de ce qu’il décrit et de ce qu’on peut observer aujourd’hui, au point de commencer à pouvoir ré-appliquer certaines de ses idées. Parce que les éléments que je retiens sont intemporels ? Peut-être, va savoir… Mais que je sache (mais peut-être que le problème vient de là), Flaubert est l’un de ceux qui nourrit le plus son œuvre des dérives du Romantisme.
Bien entendu, qu'il a nourri son œuvre de sa critique constante du romantisme. Mais du romantisme
littéraire. C'était un auteur, c'était son métier : ce qu'il écrivait n'avait peut-être rien à voir avec ce qu'il était dans la vie (grande admiratrice que je suis de Flaubert, je n'ai jamais rien lu sur sa vie et n'en veux rien savoir : la psychobiographie ne m'intéresse pas le moins du monde ; comme avait dit Jules Romains : « Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits médiocres discutent des personnes. »), et on ne peut certainement pas l'extraire justement des querelles intellectuelles qui avaient cours à l'époque.
Un poète comme Tristan Corbière a par exemple pas mal moqué l'imagerie romantique, ce n'est pas pour autant qu'on peut en faire une figure de proue des PUA.
Je crois que la chose essentielle à garder en mémoire, c'est qu'on parle d'époques et de contextes différents. Aborder une fille dans la rue au 19è siècle, c'était aborder une prostituée (enfin, si elle disait oui). Comment peut-on transposer les théories sur la séduction au 21è siècle dans des romans du 19è ? Qui ne restent que des romans, d'ailleurs ; qui ne sont en rien prescriptifs et ne donnent jamais, à aucun moment, des pistes sur la manière de vivre sa vie. Un essai pourrait donner des indications sur la marche à suivre dans sa vie personnelle, mais un roman certainement pas — ce n'est pas son but.
On est tous d'accord pour dire que l'AFC, c'est le mec à qui on a toujours dit (parce que la société a évolué au 20è siècle — nouveau problème pour mettre en parallèle Flaubert et les théories en question sur ce site) qu'il fallait être gentil avec les femmes. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est forgé une vision du monde à travers les livres ou les films : c'est surtout quelqu'un à qui on a dicté sa conduite. Et c'est un homme, le plus souvent (même si des femmes peuvent en être aussi parfois). Or, chez Flaubert, les mecs ils savent ce qu'ils veulent, et ils l'obtiennent. Il n'y a bien qu'Emma pour se retrouver ennuyée et malheureuse du soir au matin, alors que Charles Bovary est lui très heureux, de même que Rodolphe.